Richard Jacquemond
Que traduit on en arabe ?
Richard Jacquemond
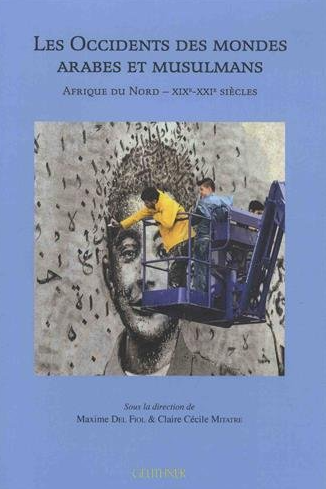
Dans un article intitulé « La traduction en arabe du
roman mondial (1991-2015). Jalons pour une enquête », publié dans Les
Occidents des mondes arabes et musulmans, Afrique du Nord XIXe-XXIe siècles, ouvrage
collectif dirigé par Maxime de Fiol et Claire Mitatre (Geuthner,
2018),
Richard Jacquemond s’intéresse à la question négligée de la
production romanesque traduite en arabe, de 1900 à nos jours, et en
retrace l’histoire et les enjeux.

Richard Jacquemond
Quelles sont aujourd’hui les spécificités de la
traduction littéraire dans le champ éditorial arabe ?
D’abord, il est difficile de s’en faire une idée
précise compte tenu de la diversification de l’édition arabe (alors
qu’autrefois Le Caire et Beyrouth étaient en position de
quasi-duopole, aujourd’hui une édition nationale s’est développée
dans la plupart des pays arabes, mais souvent les livres circulent
peu ou mal d’un pays à l’autre).
Cela dit, mes enquêtes bibliographiques m’amènent à
noter quelques tendances générales : la présence assez discrète des
genres et auteurs les plus populaires dans les marchés occidentaux
aujourd’hui (roman policier, romance, fantasy…) et,
par conséquent, de la production nord-américaine et anglo-saxonne en
général qui domine ces genres sur le marché
international. D’ailleurs il en va de même pour la littérature
nord-américaine canonique ou high brow, assez peu présente.
Les grands romanciers américains d’aujourd’hui sont
très peu visibles en traduction arabe, beaucoup moins que sur les
marchés européens en tout cas. Comparativement, les littératures
européennes (française, allemande, italienne, espagnole…) sont
plutôt mieux représentées, ainsi que la littérature d’Amérique
latine, celle de la « génération du boom » en particulier.
En revanche les autres littératures du Sud (Afrique)
et d’Orient sont peu présentes, à part quelques grands noms. Autre
particularité, la forte présence en traduction arabe des auteurs
arabes d’expression française ou anglaise, une forme de « retour du
texte » bien légitime et qui ne concerne pas que la littérature
d’ailleurs.
Vous faites ce triste constat que « à l’instar de
ses pairs travaillant vers les grandes langues centrales, le
traducteur arabe reste un écrivain de seconde main et de second
plan, qui ne s’autorise pas ou à qui on n’autorise pas les libertés
reconnues à l’écrivain de première main. » Comment dépasser
cette situation ?
C’est vrai en dehors du monde arabe aussi, mais le
problème actuellement dans l’édition arabe c’est la raréfaction des
« grands traducteurs », et aussi du profil de l’écrivain-traducteur,
qui étaient plus fréquents dans les générations anciennes, quand la
traduction avait plus de prestige parce qu’elle était associée au
projet nahdawi.
De ce point de vue la situation actuelle est plutôt
révélatrice d’une « normalisation » du statut du traducteur arabe :
il « s’invisibilise », comme le traducteur anglais ou français. Il
n’empêche que même si l’on a souvent tendance à déprécier leur
travail, je suis convaincu qu’il y a d’excellents traducteurs en
activité aujourd’hui et qu’il y en a de plus en plus au fur et à
mesure que la situation du marché éditorial s’améliore.
Il reste un problème particulier qui est lié à la
question de la diglossie fusha/darija : les écrivains de
première main ont depuis un bon moment déjà fait voler en éclat la
barrière qui séparait l’arabe écrit de l’arabe parlé, mais c’est
forcément plus difficile à faire pour les traducteurs, ne serait-ce
que parce qu’insérer de la darija dans un texte traduit d’une
langue étrangère revient forcément à le « localiser » dans un espace
particulier. Mais cela aboutit à des choses assez terribles, comme
cette traduction égyptienne du Voyage au bout de la nuit de
Céline dans un parfait arabe littéraire !
Vous plaidez pour une sociologie des traducteurs.
Pourquoi et que peut-elle apporter à la compréhension des enjeux du
secteur ?
Parce que ceux qui les exercent sont justement formés
à exercer le magistère de la parole, les métiers intellectuels sont
ceux qu’on a le plus de mal à considérer objectivement, et donc ceux
pour lesquels l’objectivation sociologique s’impose avec le plus
d’urgence. Cela vaut aussi pour les traducteurs.
Par exemple, il y a chez nous toute une mythologie du
traducteur « passeur entre les cultures » qui ne nous dit rien sur
les conditions objectives, historiquement et socialement situées,
dans lesquelles travaillent ceux qui s’adonnent à la traduction – le
plus souvent à côté d’autres activités, ce qui est justement un
élément parmi d’autres qu’on a tendance à oublier dans cette
construction mythologique du « passeur ».
Il y a eu pas mal d’enquêtes de type sociologique en
Europe ; de même en France une équipe collective vient d’achever
une Histoire des traductions de langue française – le dernier
volume paraît le 19 mai prochain. Mais de l’autre côté de la
Méditerranée, que sait-on précisément (objectivement) des
traducteurs arabes ? Pas grand’ chose. C’est un beau programme de
recherche…
Propos recueillis par Kenza
Sefrioui
8 mai 2019
Lien :
https://etlettres.com/richard-jacquemond-que-traduit-on-en-arabe/
*** *** ***

Spécialiste de littérature arabe moderne, Richard Jacquemond
est professeur à l’université Aix-Marseille au sein du
département des études Moyen-Orientales et chercheur à
l’IREMAM, l’Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe, a en effet travaillé plus de quinze ans en Égypte et
est l’auteur de nombreuses publications scientifiques
portant sur la création littéraire arabe contemporaine ainsi
que sur les travaux de traduction vers et depuis l’arabe. Il
a également traduit en français de
nombreux ouvrages (romans, nouvelles et un recueil de
poèmes) d’auteurs, surtout égyptiens, notamment Sonallah
Ibrahim. Martin Gautier