|
||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
La
Syrie et le Mandat français (1920-1946)
Samir
ANHOURY
Introduction :
colonisation et empires coloniaux
|
 |
 |
Face à elles, les
forces arabes commandées par le colonel Youssef al-Azmeh, ministre de la
guerre, sont dérisoires. Estimées à 5000 hommes environ, constituées de
toutes pièces d’un mélange de soldats, d’irréguliers, de volontaires et
de bédouins et munis de quelques canons, elles sont écrasée à Khan Maysaloun
aux portes de Damas et Youssef al-Azmeh est tué. Les troupes françaises font
leur entrée à Damas le 25 juillet 1920. C’est l’effondrement de l’éphémère
royaume arabe et le commencement du mandat français sur la Syrie qui va durer
un quart de siècle. Le roi Fayçal, chassé de Syrie, part en exil en Italie.
Il deviendra en 1921 Roi d’Irak jusqu’à sa mort en 1933.
Ainsi la Grande
Syrie ou « Bilad al-Cham » se réduit de 300.000 km2 à 185.000 km²,
avec des frontières tracées à l’est et au sud-est en plein désert en ligne
droite.
Dans le petit
livret La Syrie-géographie élémentaire, à l’usage des écoles de G.
Levenq, (Imprimerie catholique, Beyrouth, 1920), enseigné dans les écoles de
Syrie, il est intéressant de lire la définition géographique humaine et
historique de la Syrie telle qu’enseignée dès les premiers mois du mandat.
En voici quelques extraits :
« Quelles
sont les limites de la Syrie ?
La Syrie est bornée au nord par les montagnes de l’Asie Mineure que l’on appelle « le Taurus » et par ses ramifications : L’Amanus, le Kurd Dagh ; à l’est par le désert de Syrie ; au sud par le désert qui sépare l’Asie de l’Afrique ; à l’ouest par la Méditerranée. »
« Quelles
sont les dimensions de la Syrie ?
Les limites qui
viennent d’être indiquées donnent à la Syrie une figuration particulière :
c’est un pays plus long que large. Sa longueur dépasse 1000 km (la France est
un peu moins longue), mais sa largeur n’atteint pas 200 km (la France en a
900).
Sa superficie,
c’est-à-dire son étendue, est à peu près de 165.000 km².
La France est quatre fois plus grande.
« Quel
est le nom des habitants de la Syrie ?
Tous les
habitants de la Syrie peuvent à bon droit s’appeler « syriens ».
Pourquoi cela ?
Parce qu’ils
représentent un fonds commun de population qui est le même depuis des siècles
: populations sémites.
Quels sont les
différents groupements nationaux et religieux ?
I. Les
Musulmans forment la grande majorité. Ils dominent surtout dans la Syrie intérieure
et dans toutes les grandes villes, sauf Beyrouth et Jérusalem.
II. Les Chrétiens
sont tout aussi divers, et c’est depuis le milieu du Ve siècle que
la Syrie a perdu son unité religieuse.
III. Les Juifs
deviennent de plus en plus nombreux en Palestine.
Les Arabes représentent
la population nomade ou semi-sédentaire. Ceux qui sont en relations avec la
Syrie appartiennent tous à une même branche : les Anazés.
Comment cette
population est-elle répartie ?
Le pays est peu
peuplé. Autant qu’on peut le savoir la population ne dépasse pas 3 1/2
millions d’habitants.
Elle est, en
outre, très inégalement répartie. Le Liban, ainsi que sur la côte la région
de Beyrouth, sont les régions les plus denses.
D’une façon
générale, la moyenne par kilomètre carré peut aller de 13 à 8.
Pourquoi le
Syrien émigre-t-il ?
Parce que le
pays est pauvre ; parce qu’en Amérique spécialement il a pu jusqu’à présent
arriver assez vite à l’aisance. Mais le Syrien n’émigre pas sans esprit de
retour, et, en tous cas, il envoie à sa famille restée au pays, une bonne part
de ses bénéfices.
Quelles sont
les conséquences de l’émigration ?
L’émigration
contribue à dépeupler le pays, et spécialement à affaiblir l’élément chrétien ;
mais elle fournit à la Syrie un secours pécuniaire important.
Quelle est la
situation de la Syrie avant la guerre de 1914 ?
La Syrie
faisait partie, par droit de conquête, de l’empire ottoman. Légalement,
c’est par le traité de Sèvres (France) que cette situation a pris fin en août
1920.
Quel est le
sort rendu à la Syrie par le traité de Sèvres ?
Remarquons
d’abord qu’ici le mot SYRIE n’a plus le sens que nous lui avons donné en
géographie, où il comprend la Palestine. Ici, il s’en distingue.
L’empire
ottoman renonce à toutes prétentions sur ce pays et se trouve d’accord avec
les autres signataires pour que la Syrie soit reconnue ÉTAT
INDEPENDANT, à la condition que les conseils et l’aide d’un mandataire
guide son administration jusqu’au moment où elle sera capable de se conduire
seule (art. 94, 1er alinéa).
Quel est le
mandataire pour la Syrie ?
C’est la
France.
Qu’à-t-il été
statué pour la Palestine ?
L’Administration
de la Palestine, dans les frontières qui seront déterminées par les
principales puissances alliées, sera confiée à un mandataire, responsable de
l’exécution de l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif.
Le mandataire de la Palestine est l’Angleterre.
Quelles étaient
les divisions administratives de la Syrie avant 1914 ?
La Syrie était
divisée en vilayets, subdivisés à leur tour en sandjaks, et en cazas.
Les vilayets étaient
ceux d’Alep, de Beyrouth, de Syrie dont il y avait en outre deux sandjaks,
jouissant d’une situation particulière : le sandjak autonome de Jérusalem,
avec les cazas de Jaffa, Jérusalem, gaza et Hébron, et le sandjak autonome du
Liban.
Quelle était
la situation du Liban ?
Le Liban, tel
qu’il a existé jusqu’en 1920, a été définitivement créé par le statut
de 1864. En droit faisant partie de l’empire ottoman, en fait presque indépendant.
Son mutessarif qui devait être chrétien, d’une des confessions non
dominantes au Liban, était nommé pour cinq ans. Il était assisté d’un
conseil administratif élu de 13 membres (Mejless). Le Liban était divisé en 7
cazas.
Quelle est la
nouvelle organisation de la Syrie ?
L’ancienne
organisation n’a pas été maintenue.
La puissance
mandataire a procédé à une nouvelle répartition politique, comme à une
nouvelle division administrative. Cette réforme a consisté :
Quelle est la
division administrative du Grand Liban ?
Cet état est
divisé en quatre sandjaks et deux municipalités autonomes :
-
Le Liban Nord,
chef-lieu Zgarta.
-
Le Mont Liban,
chef-lieu Baabda.
-
Le Liban sud,
chef-lieu Saïda.
-
La Bequa‘, chef-lieu
Zahlé.
-
Le territoire autonome
de Beyrouth et sa banlieue.
-
Le territoire autonome
de Tripoli et sa banlieue.
Beyrouth est la
capitale du nouvel état.
Le Liban a été
agrandi. Sur la côte, il acquiert deux grandes villes, Beyrouth et Tripoli.
Mais les plus notables agrandissements sont à l’intérieur : cazas de
Hasbaya, Rachaya, Moallakat, Baalbek, tous pays de céréales.
Quels sont les
divisions administratives en Syrie ?
Sauf Alep, les
grandes villes de la Syrie intérieure : Hama, Homs, Damas sont sur son
territoire.
Tel est ce
pays. Son histoire est déjà longue et aucune autre région n’est aussi riche
en souvenirs. La Phénicie a eu les premiers colonisateurs. La Palestine a été
le pays du « peuple de Dieu », et est devenu le berceau de la
religion chrétienne. La Syrie a connu, sous les Romains et les Byzantins, une
brillante prospérité. Mais, tous ces témoins disparus, la terre qui les a
portés demeure et s’offre à nous, après tant de siècles, pour une étude féconde.
Ainsi, dans ce
petit livret de 24 pages destiné aux élèves de Syrie et du Liban, la
puissance mandataire expliquait d’une manière simple et claire son programme
politique et administratif, pensé et établi à l’évidence bien avant la
date de l’occupation de la Syrie, et source de malentendus et d’incompréhension
entre les deux parties concernées, débouchant parfois à des tensions
profondes et dramatiques.
Indépendance,
Grand Liban, états autonomes de Syrie, foyer national pour les Juifs en
Palestine : quatre points majeurs, objets de lutte, de tension et
d’instabilité politique, depuis 1918 et jusqu’à nos jours dans toute la région
du Moyen Orient.
La Syrie sous
mandat a été gouvernée successivement par 12 Hauts commissaires français, un
13e, Jean Chiappe, nommé deux jours plus tôt, meurt avant
d’arriver à destination. Son avion est abattu en Méditerranée le 17 nov.
1940, lors d’un combat aérien entre aviations anglaise et allemande. Parmi
ces douze Haut-commissaires, six étaient des militaires et les six autres des
civils, diplomates ou haut-fonctionnaires. Il est intéressant de noter que la
politique française au Levant a été exercée d’une manière directe par les
généraux Gouraud, Weygand et Sarrail entre 1920-1925, tous les trois chefs
militaires prestigieux de la guerre 1914-1918 et imprégnés d’esprit
colonial. Après la fin des troubles et de la grande révolte syrienne en
1925-1926, la Syrie fut gouvernée d’une manière relativement libérale,
avant de reprendre la voie de l’administration directe au commencement de la
Seconde guerre mondiale en 1939. Ainsi le mandat fut inauguré en 1925 par un
militaire, le général Gouraud, et un autre militaire le général Beynet
achevait, le 15 avril 1946, l’évacuation des troupes française en Syrie.
 |
 |
Cet article
relevant plus du domaine culturel que du domaine historique ou académique, il
serait trop long d’évoquer ici toute l’histoire extrêmement compliquée et
riche en événements de la période du mandat. À ce sujet, j’adresserai le lecteur à la bibliographie citée en dernière
page, susceptible d’offrir une matière bien documentée relative à cette période.
Toutefois
j’essayerai de dresser un bref bilan de l’action de la France en Syrie
seulement, (bien que l’histoire du Liban fut souvent très étroitement associée
à celle de la Syrie durant cette période), et ce qu’il en est resté dans
l’Histoire ou dans la mémoire collective.
En ce qui concerne
l’Histoire, cette action fut et reste très controversée. Les dirigeants des
grandes puissances européennes de l’époque, ceux qui ont conçu, établi et
mis en exécution le système du mandat étaient tous des hommes du 19e
s., celui de la colonisation dans toute sa splendeur, qui n’ont pas vu ou
voulu voir que la fin de la grande guerre 1914-1918 était aussi celle d’un
monde révolu, que l’écroulement de quatre grands empires européens était
aussi celui d’un système politique qui oppressait les peuples et les pays.
Les mouvements nationalistes étaient en marche et rien ni personne ne pouvait
dorénavant empêcher les peuples de réclamer et obtenir leur indépendance.
Au début de cet
article, j’avais parlé de l’échec de la politique du mandat. En effet, il
y eut échec sur plusieurs points essentiels :
 |
 |
Toutefois, et
malgré cet échec politique incontestable, il ne serait que justice
d’accorder à la France un bilan positif dans son œuvre administrative, qui a
laissé des traces profondes en Syrie jusqu’à nos jours.
 |
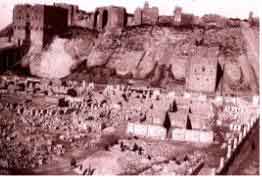 |
Le mandat a tout
d’abord consolidé les bases de l’état moderne, instauré au temps du
Royaume arabe de Fayçal. Dans ce but, le mandat a imposé son autorité grâce
à l’armée, la gendarmerie et la police garants de l’ordre et de la sécurité.
Ce dispositif, bien que répressif, fut toutefois accompagné d’une réforme
de la justice et de sa pratique dans tout le pays, assurant calme et sécurité.
Dans d’autres
domaines : santé et hygiène, cadastre, construction de routes, sédentarisation
des nomades, augmentation des surfaces cultivées, mise en valeur de l’héritage
archéologique, formation et mise sur pied de la future armée nationale :
infanterie arabe, cavaliers tcherkess, escadrons druzes, légion arménienne.
Toutes ces unités ont formé les « troupes spéciales » de l’armée
du Levant, commandée par des officiers français.
Autre
domaine, et non le moins important, fut la culture et l’éducation étendues
à des milieux socialement variés et en nombre relativement important.
L’enseignement
dans les écoles fut dispensé avec rigueur et efficacité. Le même sérieux
dans la formation des élèves et étudiants fut appliqué dans les écoles et
instituts missionnaires et dans les écoles nationales et l’Université
syrienne.
Les générations
de Syriens, formés dans ces écoles et maîtrisant souvent parfaitement à la
fois l’arabe et le français, ont formé l’élite cultivée qui a mené le
pays à l’indépendance et consolidé les réalisations positives du mandant
durant la décennie postérieure à l’indépendance. Beaucoup de ceux qui ont
vécu le mandat, qu’ils soient français ou syriens, gardent en mémoire des
souvenirs contrastés et inoubliables. Toutefois, ils sont tous à peu près
d’accord sur un point : le mandat fut une réussite administrative et un échec
politique.
Dans la mémoire
collective il est rare aujourd’hui de trouver en France quelqu’un qui se
souvienne encore de cette période. Quant aux jeunes générations de Français,
ils ignorent complètement que la Syrie faisait partie à une certaine période
de l’empire français. En effet, sitôt achevé le mandat, la Syrie a sombré
dans l’oubli des Français.
À
cela il y a peut-être plusieurs raisons :
-
L’échec global sur le
plan politique et le prix élevé en hommes et en crédits.
-
Succession de drames,
comme la guerre fratricide en 1941 qui oppose les troupes françaises sous
commandement du général Dentz, fidèles à Vichy, aux forces britanniques et
les forces françaises libres, commandées par le général Catroux.
-
En 1939, annexion par les
Turcs du sandjak d’Alexandrette. L’évacuation de ce territoire par les
troupes françaises est très mal perçue par les Syriens, s’estimant trahis
par l’état mandataire accusé d’avoir marchandé une partie du territoire
national.
-
En 1945, le général
Oliva-Roget fait bombarder Damas et son Parlement. Cet acte inconsidéré, qui
cause la mort de plusieurs centaines de civils, fait réagir les Anglais qui
neutralisent les troupes françaises. Humiliation cuisante à laquelle succède
une non moins cruelle humiliation : l’expulsion sans ménagement des Français
de Damas. Le naufrage du mandat est consommé dans la honte.

-
Enfin, et pour couronner
le tout, plusieurs anciens commandants en chef de l’armée du Levant : Dentz,
Huntziger, Gamelin, Mittelhauser sont traduits en France à la fin de la guerre
en Haute cour et insculpés de trahison.
En dehors des
troubles et des tensions politiques qui ont jalonné la période du mandat, le
pays a évolué assez vite vers la modernité et le développement, sans
bouleversement ou crise majeure. Des transformations lentes mais durables sont
intervenues dans la société au niveau des mentalités et des modes de vie. La
France de l’entre-deux guerres était encore une grande puissance et représentait
pour beaucoup de peuples un modèle de civilisation, de culture et de
savoir-vivre. Les Syriens, ouverts et tolérants par nature, qui avaient
largement contribué dans l’Antiquité à créer l’Hellénisme, ont assimilé
sans problème cette culture qui leur était offerte, recréant pour quelques décennies
dans les grandes villes du Levant : Beyrouth, Damas, Alep et dans une moindre
mesure à Lattaquié, un mode de vie propre au Levant : douceur de vivre méditerranéenne
et mélange de culture arabo-française,
ouverte sur l’Occident.
Grands hôtels,
restaurants et cafés, cinémas et théâtres, boîtes de nuit et cabarets, ont
apporté un nouveau visage à la vie citadine. Emancipation des femmes (ou de
certaines d’entre elles) qui accèdent aux diplômes universitaires et à
certains aspects de la vie politique ou professionnelle, sans pour cela vouloir
choquer les usages ou la morale traditionnels.
Evolution du
costume, surtout dans les villes ou fonctionnaires, employés, et nombre de
citadins s’habillant à l’occidentale. Mais les hommes se couvrent toujours
la tête du tarbouch. Les femmes de la bourgeoisie prennent pour modèle le chic
parisien.
Création de
plusieurs partis politiques, de plusieurs journaux et de cercles littéraires.
Les activités sportives sont en plein développement et dans certains clubs où
réunions familiales on danse le tango et le charleston. Grâce au gramophone on
entend chanter autant les grands artistes égyptiens, Abdel Wahab et Oum
Koulsoum, que français, Tino Rossi et Joséphine Baker.
 |
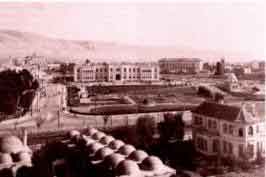 |
L’architecte
Michel Écochard
établit les plans pour l’urbanisation et la modernisation de Damas, organise
les chantiers de restauration et de conservation des monuments historiques et réalise
la construction du musée archéologique de Damas. Les habitants de Damas se
rendent à leurs occupations journalières à pied, en calèche tirée par deux
chevaux, à bicyclette ou en tramway. Bref, la vie va son train, souvent sans
heurts et sans tensions. En société, les deux populations syrienne et française
se fréquentent rarement en dehors des manifestations officielles.
Fait significatif
de l’esprit tolérant des syriens : presque tous les fonctionnaires
locaux ayant servi dans l’administration mandataire sont reconduits après
l’indépendance dans leur fonction et assurent la transition. Ils n’ont
jamais été traités de « collaborateurs » !

***
*** ***
1914
3 août : Début
de la Première guerre mondiale.
1915
août : Répression
de Djémal Pacha, à Damas et à Beyrouth, contre les nationalistes arabes.
1916
Oct. : Début
correspondance MacMahon-Shérif Hussein.
janv. :
Accord équivoque MacMahon-Hussein.
avril-mai :
Djémal Pacha exécute à Beyrouth et à Damas des nationalistes arabes, chrétiens
et musulmans.
9-16 mai :
Accords Sykes-Picot à Londres.
5 juin :
Appel à la révolte arabe lancé par le shérif Hussein de la Mecque.
nov. : Le shérif
Hussein se proclame « roi des Arabes ».
1917
11 mars :
Prise de Bagdad par les Anglais.
6 juillet
: Prise d’Akaba par les Arabes révoltés ; le major Lawrence
organise les raids.
2 nov. : Déclaration
Balfour (foyer national juif en Palestine).
1918
3 oct. : Entrée
de Fayçal à Damas.
26 oct. :
Entrée à Alep des forces britanniques et chérifiennes.
1919
18 janv. :
Ouverture de la conférence de paix à Paris.
28 juin :
Signature du traité de Versailles et du pacte de la Société des Nations.
2 juillet : Réunion
d’un Congrès national syrien à Damas.
1920
8 mars : Le
Congrès syrien proclame l’indépendance de la Syrie.
24-25 avril :
Accord de San Remo franco-britannique sur les pétroles et sur l’attribution
des mandats.
14 juillet :
Ultimatum du général Gouraud à Fayçal.
24 juillet :
Défaite de l’armée chérifienne à Maysaloun.
25 juillet :
Entrée des troupes françaises à Damas.
10 août :
Traité de Sèvres avec l’Empire ottoman.
14 sept. :
Proclamation à Beyrouth par Gouraud de la création du Grand-Liban.
24 mars :
Installation de l’émir Abdallâh en Transjordanie.
23 août :
Fayçal proclamé roi à Bagdad.
1922
3 fév. :
Accord Paulet-Newcomb sur la définition de la frontière
syro-libano-palestinienne.
24 juillet :
La société des Nations promulgue la charte du mandat syro-libanais.
1923
15 mai :
Proclamation de l’indépendance de l’Émirat de Transjordanie dirigé par Abdallâh.
1924
13 oct. : Ibn
Séoud renverse Hussein et s’empare de la Mecque.
1925
14 janv. :
Soubhi Bey Barakat devient président du nouvel état de Syrie, fusion des états
d’Alep et de Damas.
18 juillet :
Début de l’insurrection druze.
12-20 oct. :
L’insurrection s’étend à Damas. Bombardement de Damas.
21 déc. : Démission
de Soubhi Barakat.
1926
23 mai :
Promulgation de la Constitution libanaise.
Juin : Le
pouvoir en Syrie est remis au Damad Ahmad Namy Bey.
26 juillet :
Fin de l’insurrection en Syrie.
1928
8 février :
Démission du Damad. Le pouvoir est confié au cheikh Tageddine.
9 juin : Réunion
de l’Assemblée constituante syrienne à Damas.
1929
5 fév. :
Ajournement sine die par le Haut-commissaire H. Ponsot de l’Assemblée
constituante syrienne.
1930
3 mai :
Protocole final d’abornement de la frontière syro-turque.
22 mai :
Henri Ponsot promulgue le « Statut organique » des états du Levant
sous mandat français.
1931
19 nov. : Le
cheikh Tageddine démissionne.
1932
7 juin : Moh.
Ali Bey Abed est élu Président de la république.
25 nov. :
Approbation par la S.D.N. de la frontière syro-irakienne.
1933
8 sept. :
Mort du roi Fayçal. Son fils Ghazi lui succède sur le trône de l’Irak.
1934
2 nov. : Le
Haut-commissaire Damien de Martel suspend sine die la Chambre syrienne.
1936
10 janv. :
Manifestation de l’Université de Damas. Suivent plusieurs jours d’émeutes
en Syrie et 60 jours de grève générale.
Mars-mai :
À Paris, première phase des pourparlers franco-syriens sur le projet de
traité.
17 avril :
Vaste insurrection arabe en Palestine.
28 avril :
Farouk succède à Fouad comme roi d’Égypte.
3 mai :
Victoire du Front populaire en France.
20 juin : La
France confirme les frontières du Liban.
25 juin : Le
président de la délégation syrienne à Paris, Hachem al-Atassi remet une
lettre qui remet en cause les frontières libanaises.
9 sept. : Cérémonie
du paraphe du traité franco-syrien dans le salon de l’Horloge du Ministère
des affaires étrangères à Paris.
30 nov. : Les
élections en Syrie assurent le succès des nationalistes.
2 déc. : Arrêté
de rattachement du Djebel Druze à la Syrie.
5 déc. : Arrêté
de rattachement de l’État
des Alaouites à la Syrie.
22 déc. : Réunion
du Parlement syrien. Élection de Hachem al-Atassi à la présidence de la république,
formation du cabinet Djamil Mardam Bey.
26 déc. :
Ratification du traité franco-syrien par le Parlement syrien.
1937
7 juillet : À
Londres, la Commission royale d’enquête se prononce pour la partition de la
Palestine en un état juif et un état arabe, avec maintien du mandat
britannique sur Jérusalem.
Juillet :
Agitation autonomiste à Hassaké (Djezireh) en Syrie.
1938
5 juillet :
Entrée des troupes turques dans le sandjak d’Alexandrette et instauration de
la loi martiale.
2 sept. :
Élection de Taifour Sukmen à la présidence du sandjak d’Alexandrette
qui devient le « Hatay ».
18 oct. :
Journées d’émeutes en Galilée, Palestine. Les Britanniques instaurent la
loi martiale. Le Grand mufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, se réfugie
au Liban.
15 nov. : En
Turquie, Ismet Inönü succède à Mustapha Kemal.
Fin nov. :
Obstruction au parlement français à la ratification du traité franco-syrien.
24 déc. :
Coup d’état militaire en Irak. Rashid Ali s’empare du pouvoir.
1939
19 fév. : Démission
à Damas du cabinet Mardam Bey et formation du ministère Loutfi Haffar.
11-19 mars :
Fermeture des souks et agitation à Damas lors de la visite du nouveau
Haut-commissaire Gabriel Puaux. Manifestations religieuses contre l’arrêté
sur le statut personnel. Sanglantes bagarres entre le bloc National et les
partisans du docteur Chahbandar.
3 avril : Fayçal
II, âgé de 5 ans, succède à son père Ghazi 1er, tué dans un
accident d’auto. L’Emir Abdu-l-Ilah est nommé régent.
Avril :
Formation du cabinet Boukhari à Damas, qui démissionne le 15 mai.
28 juin :
Accord franco-turc : Le Hatay est annexé à la Turquie.
8 juillet : Démission
du président Atassi. Dissolution du Parlement syrien, suspension de la
constitution et formation d’un cabinet à caractère administratif confié à
Behij Bey Khatib.
2 sept. :
Commencement de la Deuxième guerre mondiale. Proclamation de l’état de siège
au Levant.
1940
17 juin :
Constitution du gouvernement Pétain et demande d’armistice.
5 août : Les
puissances de l’Axe promettent la reconnaissance de l’indépendance des
Arabes moyennant une révolte anti-britannique en Irak, en Palestine et en
Transjordanie.
7 déc. : Le
général Dentz est nommé Haut-commissaire.
1941
3 avril :
Coup d’état irakien pro-allemand de Rachid Ali al-Keilani.
4 avril : Au
Liban, démission du président Émile Eddé.
14-16 mai :
Bombardement des aérodromes de Palmyre, Damas et Ryak par l’aviation
anglaise.
31 mai : Les
Anglais entrent à Bagdad. Al-Keilani est en fuite.
8 juin : Les
troupes britanniques et les Forces françaises libres pénètrent en Syrie. Début
de la guerre du Levant.
9 juin : Déclaration
commune du général Catroux et des autorités anglaises proclamant l’indépendance
de la Syrie et du Liban.
20 juillet :
Proclamation de l’état de siège en Syrie et au Liban.
27 juillet :
Premier voyage du général De Gaulle à Beyrouth et à Damas.
9 sept. : Déclaration
de W. Churchill à la Chambre des Communes : « L’indépendance sera
restituée aux Syriens et aux Libanais sans attendre la fin de la guerre. »
19 sept. : Le
cheik Tageddine est nommé Président de la république syrienne.
27 sept. :
Proclamation de l’indépendance de la Syrie par le général Catroux et celle
du Liban 27 nov. : Alfred Naccache est nommé président de la République.
1942
11 août-8 sept. :
Voyage du général De Gaulle en Syrie et au Liban.
1943
16 janv. :
Mort à Damas du cheikh Tageddine.
18-24 mars :
Le général Catroux rétablit au Levant les systèmes constitutionnels et
promet la négociation des traités.
21 juillet :
Démission d’Alfred Naccache à Beyrouth.
26 juillet :
Élections syriennes. Succès nationaliste. Choukry al-Kouatly devient Président
de la république. Le Cabinet est formé par Saadullah al-Jabri avec Djamil
Mardam Bey aux Affaires étrangères.
29 août-19 sept. :
Élections libanaises. Bechara al-Khoury devient Président de la république,
Riad as-Solh, président du Conseil.
11 nov. :
Incidents à Beyrouth et Tripoli. Jean Helleu, délégué général par intérim,
fait établir le couvre-feu et arrêter le président de la république, le président
du conseil et plusieurs ministres.
12-16 nov. :
Protestations des autorités britanniques, égyptiennes, saoudiennes, irakiennes
et trans-jordaniennes.
16 nov. :
Retour du général Catroux à Beyrouth. Rappel de Jean Helleu et rétablissement
dans leurs fonctions des hommes politiques libanais emprisonnés.
22 déc. :
Signature d’accords prévoyant le transfert, à partir du 1er
janvier 1944, aux autorités syriennes et libanaises, les attributions exercées
en leur nom par la France.
1944
10 janv. :
Transmission aux états de Syrie et du Liban des services d’intérêt commun
de la police, des passeports, de la presse et des postes.
5 fév. :
Transfert aux autorités syriennes et libanaises des services financiers et économiques.
10 fév. : Le
général Beynet est nommé Délégué général à Beyrouth, le diplomate Ives
Chataigneau ayant assuré l’intérim depuis le départ de Jean Helleu.
mars-sept. :
L’Arabie Saoudite (29 mars), le Yémen (21 avril), la Chine (10 mai), la
Transjordanie (31 mai) et l’Iran (23 septembre) reconnaissent l’indépendance
de la Syrie et du Liban.
25 sept.-10 oct. :
Congrès général arabe à Alexandrie. Signature d’un protocole d’accord prévoyant
la création d’une Ligue des états arabes.
16 oct. : Démission
du gouvernement syrien. Formation à Damas du cabinet Faress al-Khoury.
1945
10 mai :
Émeutes à Damas. Les escadrons druzes et la gendarmerie syrienne font défection.
16 mai : Débarquement
à Beyrouth de renforts de troupes françaises.
27 mai :
Attaque et destruction d’un convoi militaire français à Homs.
28 mai : Harcèlement
des postes français par la gendarmerie syrienne, équipée d’armes anglaises.
29 mai : Le général
Beynet fait bombarder les édifices publics à Damas. Le gouvernement syrien
quitte la capitale.
30 mai :
Ultimatum britannique remis à l’ambassadeur français René Massigli à
Londres. Paris donne l’ordre de cessez-le-feu.
14 juin :
Entrée spectaculaire à Beyrouth du général Paget, Commandant en chef
britannique en Orient.
1946
20 janv. : Le
général De Gaulle démissionne de la présidence du gouvernement provisoire.
14 fév. : Le
Conseil de sécurité des Nations unis discute la demande syro-libanaise d’un
retrait total des troupes étrangères.
30 avril :
Évacuation de la Syrie par les dernières troupes françaises.
31 août :
Évacuation du Liban par les dernières troupes françaises.
***
1. Chefs des
gouvernements syriens du 27 septembre 1918 au 11 juin 1932.
1918
27-30 sept. :
l’Émir
Saïd al-Jazairi
1918-1920 :
30/9/18-26/1/20 : Rida Pacha al-Rikabi
1920 :
26 janv.-8 mars :
l’Émir
Zaïd Ibn al-Hussein
9
mars-3 mai : Rida al-Rikabi (2)
3-5 mai : Hachem
al-Atassi
5 mai-24 juillet :
Hachem al-Atassi (2)
juillet : Ala’
al-Droubi
6 sept.-30 nov. :
Jamil al-Ilchi
1920-1922 :
1er déc. 20- 28 juin 22 : Hakki al-Azem
1922-1924 :
28 juin 22-10 déc. 24 : Soubhi Barakat
1924-1925 :
10 janv. 24-31 août 25 : Soubhi Barakat (2)
1925 :
31 août-21 déc. : Soubhi Barakat (3)
1926 :
9 fév.-26 avril : le Français Pierre Alype
26 avril-12 juin :
Damad Ahmad Nami
12 juin-2 déc. :
Damad Ahmad Nami (2)
1926-1928 :
2 déc. 26-8 fév. 28 : Damad Ahmad Nami (3)
1928-1930 :
15 fév. 28-14 août 30 : Cheikh Taj al-Hassani
1930 :
14 août-27 oct. : Cheikh Taj al-Hassani (2)
1930-1931 :
27oct 30-19 nov. 31 : Cheikh Taj al-Hassani (3)
1931-1932 :
19 nov. 31-11 juin 32 : le Français Léon Solomiac.
***
2) Présidence
de la République syrienne du 11 juin 1932 au 29 mars 1949
Première présidence :
Président de la république :
Mohammad Ali al-Abed (11 juin 1932-14 novembre 1936)
Chef du
gouvernement :
-
Hakki al-Azem :
15/6/1932-3/5/1933
-
Hakki al-Azem (2) :
3/5/1933-7/3/1934
-
Cheikh Taj al-Hassani :
17/3/1934-24/2/1936
-
Ata al-Ayoubi :
24/2/1936-21/12/1936
Président de la république
: Hachem al-Atassi (15 novembre 1936-7 juillet 1939)
Chef du
gouvernement :
-
Jamil Mardam Bey :
21/12/1936-26/7/1938
-
Jamil Mardam Bey (2) :
26/7/1938-23/2/1939
-
Loutfi al-Haffar :
23/2/1939-5/4/1939
-
Nassouhi al-Boukhary :
5/4/1939-8/7/1939
Gouvernements
administratifs de transition :
Président Bahij
al-Khatib : 9/7/1939-1/4/1941
Président Khaled
al-Azem : 5/4/1941-12/9/1941
Président de la république
cheikh Tajeddin al-Hassani (non élu, mais désigné par le général Catroux) :
12 sept 1941-17 janvier 1943
Chef du
gouvernement :
-
Hassan al-Hakim :
20/9/1941-17/4/1942
-
Housni al-Barazi :
18/4/1942-8/1/1943
-
Jamil al-Ilchi :
8/1/1943-25/3/1943 (Chef de l’état à la mort du président al-Hassani en
janvier 1943)
-
Ata al-Ayoubi
25/3/1943-Août 1943 (Chef de l’Etat)
Président de la République
Choukri al-Kouatly : 17 août 1943 – renversé par coup d’état
militaire du colonel Housni al-Zaïm le 29 Mars 1949
Chef de
gouvernement :
-
Sa’adallah al-Jabiri :
19/8/1943-14/11/1944
-
Faress al-Khoury :
14/11/1944-7/4/1945
-
Faress al-Khoury (2) :
7/4/1945-24/8/1945
-
Faress al-Khoury (3) :
24/8/1945-30/9/1945
-
Sa’adallah al-Jabiri :
(2) 30/9/1945-27/4/1946
-
Sa’adallah al-Jabiri :
(3) 27/4/1946-27/12/1946
-
Jamil Mardam Bey :
28/12/1946-6/10/1947
-
Jamil Mardam Bey (2) :
6/10/1947-22/8/1948
-
Jamil Mardam Bey (3) :
22/8/1948-16/12/1948
-
Khaled al-Azem :
16/12/1948-29/3/1949
*** *** ***
Bibliographie
-
Attar,
Abdu-r-Rahman,
Qissat al-noukūd
wa-l-masāref
fī
Sūriya
(1880-1980).
-
Berchet, Jean-Claude, Le
voyage en Orient, Robert Laffont.
-
Corm, Georges, Le
Proche-Orient éclaté (1956-2000), Folio-Histoire.
- Esber, Amin, Tatawwor al-nuzom as-siyāsiyat wa-l-dustūria fi Sūriya, Dar an- Nahār, Beyrouth.
-
Fournier, Pierre et Jean
Louis Riccioli, La France et le Proche-Orient (1916-1946), Casterman
-
France, Syrie et Liban
(1918-1946), Publication
I.F.E.A.D., Damas.
-
Hitti, Philip, History
of the Arabs. Macmillan Student Editions.
-
Hureau, Jean, La Syrie
aujourd’hui, Éditions
J.A.
- Jabbour, Georges, Khawāter mujaddada : Mustakbal al-wahda al-‘Arabiyya, Alef-Bā’, Damas.
-
Kassab-Hassan, Najat, Jīl
al-Chajā‘a
2, Alef-Bā’,
Damas.
-
Mansel, Philip, Splendeur
des sultans (Les dynasties musulmanes : 1869-1952), Balland.
-
Mardam Bey, Salma, Awrāk
Jamīl
Mardam-Bek (1939-1945),
Charikat al-Matbu‘āt,
Beyrouth.
-
Perrin-Naffakh,
Anne-Marie, Syrie, Petite Planète.
-
Picaudou, Nadine, La Décennie
qui ébranla le Moyen Orient (1914-1923), Éditions
complexe.
-
Rioux, Jean-Pierre, Fins
d’empires, Plon.
-
Rondot, Philippe, La
Syrie, Coll. « Que sais-je ? », Presses Univ. de France.
-
Rondot, Pierre, Les
Chrétiens d’Orient, J. Peyronnet et Cie Éditeurs.
-
Samman, Mouti‘, Watan
wa ‘askar, Bisān.
-
Tlass, Moustapha et
Joseph Hajjar, L’histoire politique de la Syrie contemporaine (1918-1920),
Tlassdar.
-
Valognes, Jean-Pierre, Vie
et mort des chrétiens d’Orient : Des origines à nos jours, Fayard.
-
Wilson, Jeremy, Lawrence
d’Arabie, Denoël.
ÇáÕÝÍÉ ÇáÃæáìFront Page |
ÇÝÊÊÇÍíÉ |
ãäÞæáÇÊ ÑæÍíøÉSpiritual Traditions |
ÃÓØæÑÉMythology |
Þíã ÎÇáÏÉPerennial Ethics |
òÅÖÇÁÇÊSpotlights |
ÅÈÓÊãæáæÌíÇEpistemology |
ØÈÇÈÉ ÈÏíáÉAlternative Medicine |
ÅíßæáæÌíÇ ÚãíÞÉDeep Ecology |
Úáã äÝÓ ÇáÃÚãÇÞDepth Psychology |
ÇááÇÚäÝ æÇáãÞÇæãÉNonviolence & Resistance |
ÃÏÈLiterature |
ßÊÈ æÞÑÇÁÇÊBooks & Readings |
ÝäøArt |
ãÑÕÏOn the Lookout |
|
|
|
|